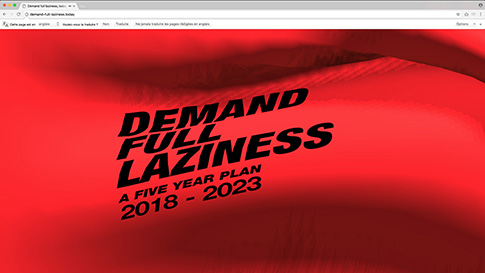ART BRUSSELS 2018
par Dominique Moulon [ Avril 2018 ]
Art Brussels agit tel un catalyseur tant cette foire qui fête cette année ses cinquante ans est suivie par les institutions, galeries et collectionneurs qui en profitent pour programmer des événements phare à ce moment-là. Ainsi en avril, les expositions se chevauchent, du Wiels à la Centrale ou la Raffinerie en passant par la Société d’électricité ou encore Senne.

Souvenirs d’utopies
Pierre Jean Giloux,
“Invisible Cities -
Japan Principle Part 2,
Egg of Wind”, 2015.
 C'
C'est au sein de la zone de la foire d’art contemporain
Art Brussels dédiée aux galeries émergentes que le stand de la
Fédération Wallonie-Bruxelles soutient les créations photographiques et filmiques de l’artiste français
Pierre Jean Giloux. Là où, notamment, l’une de ses “Invisible Cities ” datant de 2015 est traversée par un objet des plus énigmatique. Il a la forme et la lenteur du dirigeable qui survole Miami en scandant « The world is yours » dans Scarface. Ce dont on doute encore cinquante années après ce printemps que l’on a peine à oublier. La ville que Pierre Jean Giloux nous présente est japonaise ; les polygones de l’objet qui l’habite nous renvoient au calcul des machines. Et ce sont précisément ces facettes apparentes qui en trahissent la véritable provenance. Car ce volume elliptique existe, dans le vrai monde et très exactement à Tokyo. Il se nomme “Egg of Wind” et a été déposé telle une énigme au pied de tours en béton par l’architecte Toyo Ito. Notons que ce dernier a été fortement inspiré par le collectif des années soixante Archigram qui est à l’origine du concept d’utopie urbaine de “Walking City”. Serait-ce notre renoncement collectif aux utopies passées qui hanteraient la mégapole qu’on nous présente ici ?

Des sanglots longs
Saadan Afif
"Black Chords",
2006.
 I
Il est des sons se répétant au second étage du centre d’art contemporain le
Wiels qui, inexorablement, nous attirent vers la salle de l’installation ”Black Chords” (2006) de l’exposition Paroles d’un autre artiste français : Saadan Afif. Celui-ci y a disposé les treize guitares électriques Les Paul qui sont raccordées à autant d’amplificateurs Epiphone. Mais aucun guitaristes où les spectatrices et spectateurs déambulent entre les instruments de musique que l’artiste a automatisé avec les mécanismes qui, de temps à autre, les activent. Les guitares sont diversement accordées et la lenteur du jeu que l’on impute à un programme informatique nous évoque un concert qui, jamais, ne commencera véritablement. Inutile alors d’essayer de saisir les mécanismes s’activant subrepticement. Mais, dans la fosse d’un orchestre répétant, parviendrait-on à repérer d’où proviennent les sons ? On s’abandonne donc à cette musique d’une ambiance tout droit sortie d’un film de David Lynch. Une forme de rondeur émerge de la répétition des six sons que ces guitares autonomes émettent. L’on se plaît à les imaginer sans public aucun, jouant toutefois les notes de la partition qui les relie les unes aux autres pour verser alternativement des ”sanglots longs” qui nous atteignent d’une “langueur monotone”.

De la surveillance
Paul Pfeiffer,
“Self portrait as a
fountain”, 2000.
 L
La
Centrale pour l’art contemporain, durant cette éditions d’Art Brussels, nous présente onze collections dont celle des Vanhaerents où l’on découvre l’installation vidéo “Self portrait as a fountain” (2000) de l’artiste américain Paul Pfeiffer. C’est un hommage à l’hommage si l’on considère la photographie au titre éponyme et datant de la fin des années soixante de Bruce Nauman. Quand Marcel Duchamp, eu égard au titre de son œuvre iconique, Fontaine, n’est pas bien loin. Mais c’est aussi et surtout un hommage à Alfred Hitchcock puisque l’on reconnaît immédiatement le décor de la scène de la douche du film Psycho de 1960. L’eau coule et il ne manque plus que l’actrice alors que des perches, équipées de caméras, reprennent les angles de vue du réalisateur pour qu’un écran les diffuent successivement et en temps réel tout à côté de la reconstitution. Et l’on se souvient de notre stupéfaction lorsque, à la fin du siècle précédent, nous nous sommes sentis épiés de toute part sans trop savoir si cette surveillance extrême devait nous rassurer. A cela aussi nous nous sommes habitués jusqu’à ce que la surveillance prenne d’autres formes et que nous y participions activement avec les médias sociaux. Dans l’attente impatiente de l’interconnexion de nos salles de bains, derniers retranchements de l’intime, pour qu’ensemble nous fassions du monde « a better place » !

Sans jugement aucun
Jon Rafman,
“Nine Eyes”,
2008-2018.
 C'
C'est dans l’ancienne société Bruxelloise d’Électricité que Manuel Abendroth et Els Vermang du trio LAb[au] ont initié la plate-forme où ils présentent l’exposition Earth & Sky. L’idée étant de « questionner la manière dont les technologies influencent notre paysage ». Où l’on découvre des tirages aux allures de photographies de reportage de
Jon Rafman. Le corps étendu sur le sol et recouvert d’un drap nous évoquant les clichés de Weegee qui, dès les années 30, écoutait les fréquences radiophoniques de la police pour être le premier à photographier les scènes de crime. Mais nul besoin pour Jon Rafman de se presser sur les lieux d’un accident puisque les google cars sillonnent le monde et sont là pour le documenter sans jugement aucun. L’intérêt de l’exposition Earth & Sky émerge aussi du dialogue entre les œuvres et du rapprochement entre les pratiques. Ainsi, à côté des captures de la série “Nine Eyes” initiée en 2008 par la collecte d’images singulières sur Street View, il y a le livre de l’artiste d’Ed Rusha qui s’est astreint, en 1966, à photographier tous les bâtiments de Sunset Strip, les uns après les autres depuis l’arrière d’un pick-up. Pour Rusha comme pour Rafman, c’est en délégant les prises de vues constituant des séries qu’ils font œuvre. Allant de l’ultra-ordinaire pour l’un à l’extraordinaire pour l’autre.

Susciter l’accident
Clement Valla,
“The Universal Texture
recreated”, 2014.
 R
Restons un temps à la
Société d’Électricité où une autre installation est consécutive à l’usage ou plutôt au détournement artistique d’un autre service de Google, c’est-à-dire Earth. Datant de 2014, elle s’intitule “The Universal Texture recreated”. L’artiste
Clement Valla, qui depuis 2010 collecte les vues satellites que l’entreprise américaine ne saurait représenter sans y injecter sa part d’erreur, met ici en scène l’accident. Il a, comme à son habitude, extirpé une image satellitaire de l’Internet pour la recontextualiser dans l’espace de l’exposition. Imprimée sur de la toile, elle recouvre ce qui pourrait être une table étonnamment assemblée. De façon à ce qu’émerge un accident dans le territoire. Ainsi, il se substitue à l’appareillage de Google dans son incapacité à représenter les infrastructures routières sans les liquéfier quelque peu lorsqu’elles traversent des vallées ou cours d’eau. Les images de la série qui l’a fait connaître à l’international sont présentées, comme il ce doit, telles autant de “
Postacards from Google Earth” sur un présentoir rotatif. Un dialogue s’établit alors entre des accidents attendus et un accident suscité. L’humain égalant ici la machine dans sa capacité à créer de l’étrangeté dans un paysage représenté.

La question de l’identité
Emilio Vavarella,
“The Digital Skin Series.
Toshiaki”, 2016.
 L'iMAL
L'iMAL de Bruxelles étant en rénovation, c’est à la Raffinerie qu’Yves Bernard accueille l’exposition #Layers du curateur italien Fabio Paris co-fondateur avec Lucio Chiappa et Domenico Quaranta du
Link Art Center. Le digital est donc au centre des pratiques ou problématiques ainsi regroupées. Car le titre de l’exposition, selon son commissaire, « fait référence à la superposition des multiples formes que prend la complexité numérique dans les œuvres présentées ». Ce que l’on vérifie avec le tirage de “The Digital Skin Series” (2016) d’
Emilio Vavarella. Où il est encore question d’une forme de collision entre ce qui est plat et ce qui ne l’est pas. La planéité étant celle des photographies des visages de gens ordinaires que l’artiste a rencontré alors que le volume sur lequel sont plaqués ces mêmes visages est celui du crâne virtuel de l’artiste lui-même. De ces plaquages ou collisions émerge une forme de monstruosité à l’époque où les greffes de visages se banalisent et où l’on envisage même la transplantation de têtes ou même de corps entiers considérant que le lieu de l’être et du soi est le cerveau. Les représentations de l’artiste ayant en commun avec les pratiques chirurgicales de questionner la notion d’identité quand le courant transhumanisme va jusqu’à imaginer l’esprit s’émancipant de son enveloppe corporelle !

Eloge de la paresse
Guido Segni, “Demand full laziness, today. A five-year
plan for the dull automation of art production”, 2018-2023.
 F
Force est de reconnaître que nous avons, ces dernières décennies, confié notre connaissance aux serveurs de fichiers avant de déléguer notre raisonnement à des intelligences artificielles. Que ferons-nous lorsque nous aurons enfin remplacé nos membres inutiles par des bras robotisés ? La réponse qui nous est donnée au sein de l’exposition #Layers par
Guido Segni est quelque peu radicale : rien, absolument rien. Nous nous adonnerons enfin à la paresse comme le titre du projet à long terme “
Demand full laziness, today. A five-year plan for the dull automation of art production” initié cette année. Cet autre artiste italien a commencé par préparer la machine, devant s’améliorer par elle-même comme il ce doit en deep learning, pour qu’elle crée à sa place. Car celle-ci est programmée pour effectuer le portrait de l’artiste se prélassant devant elle. Et c’est parce qu’il faut un modèle économique à tout projet que nous avons la possibilité de le produire collectivement au travers de la plateforme de financement participatif patreon.com. Mais n’est-ce pas le rêve ultime, à en croire le succès des jeux d’argent, que d’être rémunéré sans contre partie ? Au gouvernement finlandais de tester le revenu universel !

Des spécifiés du digital
Flavia Da Rin,
“Untitled”, 2006.
 R
Rnfin, terminons notre parcours par le solo show de l’artiste argentine Flavia Da Rin que le collectionneur Thierry Tilquin a organisé au sein de son espace d’exposition intitulé Senne. L’essentiel des œuvres présentées datent du milieu des années 2000. Il s’agit-là d’un détail important. Car elles préfigurent tant la mode des selfies que celle des effets de Snapchat. Notamment celui dont nous nous amusons quand il magnifie nos regards. Mais face à autant d’autoportraits aux pixels “maquillés”, on pense inévitablement à celles qui n’a cessé de se grimer face à l’objectif : Cindy Sherman. Le travail de Flavia Da Rin peut être considéré telle une étape essentielle entre les histoires que nous racontaient Cindy Sherman et celles, plus récentes et médiatisées par Instagram, d’Amalia Ulman. L’histoire de l’art est ainsi faite de passages allant dans ce cas de la transformation à la retouche et jusqu’au partage. C’en est ainsi, le digital a irrémédiablement contaminé la sphère des artistes, curateurs et autres critiques en passant par les collectionneurs ou institutions.

Article rédigé par Dominique Moulon pour la revue TK-21, Avril 2018.